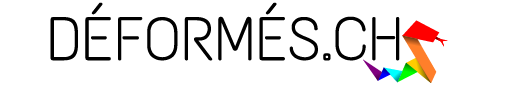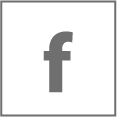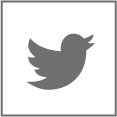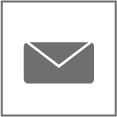Décès de François: réactions du monde chrétien suisse
«François a montré l’exemple»
Jerry Pillay, pasteur et secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises (COE)
«Son pontificat a marqué un tournant, notamment pour le mouvement œcuménique, car il a accordé une attention particulière à l’unité chrétienne». Pour le pasteur Jerry Pillay, «la lutte de François contre l’urgence climatique et son engagement constant contre les injustices sociales ont été déterminants dans la façon dont l’Église se positionne face aux défis contemporains». Jerry Pillay espère que son successeur continuera dans cette voie, en réaffirmant «l’importance de la solidarité et des droits des plus vulnérables». Pour lui, «François a montré l'exemple de ce que doit être une Église réellement engagée dans les réalités du monde, sans jamais perdre de vue la dignité de chaque être humain». Il cite encore avec émotion les paroles du pape lors de leur dernière rencontre: «S’il vous plaît, priez pour moi et ma tâche.»
«Il a dû faire preuve de prudence»
Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion
Le Valaisan se souvient surtout avec émotion de sa visite en 2013 à Lampedusa, où «François a symboliquement tendu la main aux réfugiés en leur offrant des cartes téléphoniques pour appeler leurs proches, un geste simple mais plein de sens». A ses yeux, estime-t-il, l’héritage de François repose avant tout sur «sa capacité à réformer l’Église en mettant en avant des principes de synodalité». Or, souligne-t-il, en dépit de son réel désir de changement, «François a parfois dû faire preuve de prudence» face à des mentalités encore un peu braquées. «Il a préféré attendre que les tensions internes se dissipent avant d’engager certaines réformes. Il a même été obligé de renoncer à l’intégration des femmes au diaconat pour ces raisons-là.»
«Ses engagements ont eu un impact au-delà de l’Eglise catholique»
Rita Famos, pasteure et présidente de l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS)
«Les images du pape François, seul sur la place Saint-Pierre sous la pluie, priant pour le monde pendant la pandémie, restent gravées» dans sa mémoire. Rita Famos l’avait rencontré à Rome alors qu’elle faisait partie de la délégation d’Ignazio Cassis, à l’occasion de l’assermentation des gardes suisses. Pour la pasteure zurichoise, «l’engagement de François pour la justice sociale, la préservation de la Création et la solidarité avec les marginalisés a eu un impact bien au-delà de l’Eglise catholique». Toutefois, «sur la question de l’égalité ou de la reconnaissance de la diversité au sein de l’Eglise», elle aurait «souhaité des avancées plus audacieuses», reconnaît-elle.
«Des ponts au-delà des frontières religieuses»
Markus Ritter, conseiller national saint-gallois du Centre
Markus Ritter a toujours admiré la personnalité du pape François, dont il veut saluer la capacité à «établir des ponts au-delà des frontières religieuses». Selon lui, «François n’a eu de cesse de vouloir être proche de tous, ce qui lui a valu d’être respecté même au-delà de la communauté chrétienne». Le conseiller national souligne son engagement «envers les plus pauvres et les nécessiteux», incarnant l’esprit de l’Évangile dans un monde marqué par l’individualisme. Bien que son pontificat ait été marqué par des défis conséquents, notamment concernant ses réformes, Markus Ritter n’a aucune critique à formuler à l’encontre du pape François.
«François a lié la préservation de la nature à une exigence morale»
Anne Abruzzi, membre du Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV)
Elle se souvient avec émotion de sa rencontre avec lui, en 2022, alors qu’elle accompagnait une délégation œcuménique d’aumôniers en écoles professionnelles et gymnases. Elle en était ressortie «les larmes aux yeux». Pour elle, François a marqué «un tournant dans l’histoire moderne de l’Église catholique, en s’engageant théologiquement sur des questions cruciales telles que la préservation de l’environnement et la dignité humaine». À travers ses encycliques telles que Laudato Si’ et Laudate Deum, «François a souligné que le respect de l'environnement est indissociable du respect de l’autre. Et que l’écologie, ce n’est pas que l’amour des fleurs: c’est une révérence à la Création confiée par Dieu».
«Son Eglise comme un hôpital de campagne»
Raphaël Pomey, rédacteur en chef du journal «Le peuple» et catholique pratiquant
Le journaliste vaudois évoque avec nostalgie «l’enthousiasme vécu au début du pontificat de François», qu’il considérait au début comme un véritable «vent de fraîcheur pour l’Église catholique». Son idée de présenter l’Église comme un «hôpital de campagne», soit une institution dont la mission est de venir en aide aux souffrances humaines, a résonné profondément chez lui. Et Raphaël Pomey exprime avoir apprécié «son effort pour assouplir certains aspects du catholicisme, rendant la foi plus accessible dans un monde moderne». Il ose enfin critiquer le progressisme «à tout crin» de François qui a «divisé l’Église, notamment au sein de la jeunesse. Cette dernière, parfois attirée par la tradition, a eu le sentiment de ne pas être entendue par l’autorité papale».
«L’importance des périphéries»
Isabelle Jonveaux, sociologue des religions à l’Université de Fribourg et responsable de l’antenne romande de l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI)
L’universitaire française souligne «l’importance de l’attention portée par François aux périphéries de l’Église, notamment aux plus vulnérables». Elle estime que cet engagement «marque un tournant dans la mission de l’Église, en plaçant la solidarité et l’attention aux plus fragiles au cœur de son action». Cependant, elle déplore que «la question du diaconat féminin, pourtant ouverte par François, n’ait pas été approfondie». Elle espère que le prochain pape saura réduire les clivages internes, entre progressisme et traditionnalisme, et continuer à décloisonner l’Église, notamment aux jeunes générations. Isabelle Jonveaux souligne encore «l’importance de l’interculturalité, souhaitant que l’Église s’adapte aux contextes locaux tout en restant fidèle à ses principes universels».