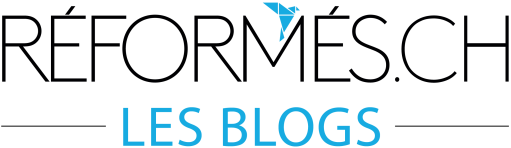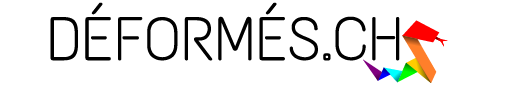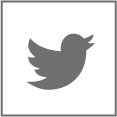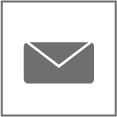"Nous redevenons des païens"
Propos recueillis par Jean-Luc Mouton et Frédérick Casadesus, de l'hebdomaire français Réforme
Nous assistons périodiquement à une montée des peurs vis-à-vis de l’islam.
Comment l’analysez-vous ?
Il faudrait distinguer le court terme et la longue durée. Pour l’actualité, l’affaire des minarets
représente une petite réaction hystérique, xénophobe, politicienne, qui ne sent pas très bon. Le vieil antisémitisme du terroir est mort et le racisme est devenu islamophobique. Certes, un antisémitisme perdure, mais il est d’importation, de procuration ; c’est le ricochet du conflit israélo-arabe dans les cités. (...)
Maintenant, si l’on regarde la longue durée, il faut relever que nos religions sont devenues molles alors que l’islam est une religion dure. Nous vivons une phase d’insurrection identitaire dans une partie du monde arabo-musulman. Je l’analyse comme un choc en retour, c’est-à-dire que la globalisation technique et économique produit son contre-effet dans une balkanisation politique et culturelle du monde. A la globalisation matérielle correspond une fragmentation morale, culturelle et éthique. C’est ce que nous appelons en médiologie l’effet "jogging": plus vous construisez d’autoroutes, plus les gens ont envie de marcher.
Quand j’étais en Algérie ou en Tunisie, dans les années soixante-dix, je constatais avec surprise que les fondamentalistes s’étaient emparés des facultés des sciences et qu’ils n’avaient donc rien à voir avec la caricature classique de l’intégriste en djellaba et en babouche, hirsute et rustique, sortant de sa médina.
Le progrès technique délocalise, le retour aux sources relocalise.
Ce sont les acteurs des secteurs de pointe qui trouvaient dans l’affirmation de leurs traditions propres les repères spirituels qu’ils redoutaient de perdre. Le progrès technique délocalise, le retour aux sources relocalise. Le progrès est ainsi fait que, lorsque vous désorientez quelqu’un en l’insérant dans un mode de vie indifférencié, en multipliant les non-lieux (aéroports, autoroutes), vous multipliez les appétences patrimoniales. Dans les années trente, un futurologue avait prédit que les citadins, à force de conduire des automobiles, allaient
avoir les membres inférieurs atrophiés. L’évolution récente a démontré que les futurologues se trompent souvent et que les citadins mobilisés par l’automobile pratiquent le jogging – c’est le sens de la métaphore que nous utilisons en médiologie.
L’idée de progrès est niaise dès lors que l’on ne distingue pas la sphère culturelle et la sphère technique, dès lors que l’on imagine que, parce que l’on va donner aux gens des rudiments de mathématiques, des rasoirs électriques et un ordinateur, on va en faire des hommes modernes, c’est-à-dire des hommes qui vivent selon les critères du monde occidental. Or, ce n’est pas le cas. Ces hommes vont être déstabilisés, atomisés par ce nivellement des outils et vont spontanément retrouver ce qu’il y a en eux d’irréductible, l’empreinte de leur enfance. On peut dire la chose de manière plus triviale : plus vous mettez de Coca-Cola dans un pays, plus vous récoltez d’ayatollahs !
L’inverse est vrai aussi. C’est un phénomène de fond qui a été aggravé par les stratégies occidentales qui, pour faire pièce au progressismenational laïc, ont systématiquement poussé en avant les milieux religieux traditionalistes. C’est ce qu’a fait l’Amérique en Arabie Saoudite et en Afghanistan, c’est ce qu’Israël fait avec le Hamas pour nuire au Fatah. Ce que nous disons là du fondamentalisme musulman vaut aussi pour le fondamentalisme hindou : c’est à Bombay, dans les entreprises qui travaillent dans le domaine le plus "high tech", que l’on rencontre le plus grand nombre d’intégristes.
Mais au contact de l’Occident, l’islam ne peut-il pas évoluer ?
Je ne suis pas compétent mais je crois pouvoir identifier une course de vitesse entre deux courants. Le premier courant, c’est la radicalisation des enclaves islamiques dans la société européenne. (...) N’oubliez jamais que les intégristes viennent de l’exil : c’est à Londres que l’on a brûlé le livre de Salman Rushdie. (...)
Un second courant existe pourtant, celui d’une avancée réformiste, c’est-à-dire l’invention d’un islam sécularisé, assoupli, prenant en compte les acquis de l’histoire contemporaine, disons un islam réformé. Oui, il existe des réformateurs de l’islam. (...) J’ai demandé à ces musulmans réformistes si nous allions vers un rigorisme accentué par réaction à la modernité ou bien vers une Réforme à la manière protestante. A dire vrai, ils ne le savent pas encore. L’issue est incertaine. (...)
Mais comment marquer les limites de que nos sociétés acceptent ou non ?
J’ai fait partie de la commission Stasi, qui portait sur l’école et qui, très vite, s’est consacrée àla question du voile. Dans mon esprit, il s’agissait de sanctuariser l’école ; j’ai fait valoir que la vie sur la planète est un échange de politesses. Lorsque nous allons à Istanbul ou Damas, nous enlevons nos souliers en entrant dans une mosquée. En réciprocité, quand on va à l’école de la République, on retire son voile. J’ajoutais qu’il ne fallait pas retirer seulement le voile, mais la kippa, la croix et les logos publicitaires. Cela me semblait indispensable mais a été pris comme une remarque réactionnaire. Notez que cela me laisse d’autant plus libre pour dire qu’une loi contre la burqa n’a pas lieu d’être. Tout d’abord parce qu’elle ne tiendra pas le coup devant le Conseil d’Etat. Mais aussi parce que cela revient à stigmatiser une religion plus que d’autres à partir d’un phénomène marginal. Il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de se crisper, sauf à faire le jeu d’une escalade intégriste.
Comment analysez-vous le débat lancé par le gouvernement sur l’identité nationale ?
L’identité de la France, c’est d’abord la langue française. Or, ceux qui nous demandent d’y réfléchir sont les premiers à maltraiter notre langue, à parler l’anglais dès qu’ils mettent le pied à Strasbourg ou à Bruxelles… Une identité, c’est une histoire. On la rend facultative à l’école. Tout cela est grotesque. Je ne vais pas quand même pas aller en préfecture pour discuter de tout cela ! Ce débat révèle un grand désarroi psychologique dans notre pays...L’identité française résulte d’une sédimentation de quinze ou dix-sept siècles, avec des strates successives culminant par une formule très originale qui était celle de la République. La France, c’était l’école, l’armée, un certain type de paysage, une certaine façon de jardiner, de manger, bref, c’était un rapport au monde. Dans un livre intitulé La puissance et les rêves, j’avançais que la France était le pays de l’eau vive, ce qui la distingue des pays d’Océan comme la Grande-Bretagne, les pays de lacs comme la Suisse ou des nations de forêts. On touche là à des inconscients matériels. La France est àla fois un héritage et une pratique : on ne peut pas être fier d’être français ; on peut être fier de faire la France.
Le champ politique semble aujourd’hui mal en point. Comment analysez-vous l’évolution du politique ?
Trois cycles ont pris fin. Le premier cycle, court, s’est cristallisé au moment de la Seconde Guerre mondiale et de la Libération, résumé par Malraux quand il disait : il y a les communistes, les gaullistes et rien. Aujourd’hui, il n’y a plus de communistes, plus de gaullistes et le "rien" est devenu "tout".
Le deuxième cycle a commencé en 1789, qui a marqué la naissance de la passion politique, de la politique comme religion et même de la politique tout court puisque c’est à partir de 1789 que les notions de gauche et de droite sont apparues. Les hommes se sont regroupés non plus en fonction d’allégeances familiales, régionales ou confessionnelles mais en
fonction d’une certaine conception de l’homme. La politique est née alors en tant qu’affrontements d’idées, de visions du monde – ce qui n’empêchait pas les querelles économiques et sociales mais mettait du jeu entre les appartenances sociales et les fidélités politiques. Je dirai un peu arbitrairement que ce système est mort en 1968, dans un festival d’hyperbole superlative qui n’était que le feu d’artifice avant fermeture. Un an plus tard, l’homme posait le pied sur la Lune et cette image matricielle de la Terre vue du dehors, comme vaisseau, a provoqué un choc de représentation : l’homme s’est regardé comme espèce.
Nous avons quitté l’histoire pour la nature : cela s’appelle l’écologie.
Le troisième cycle est né avec Jésus- Christ, quand l’homme a donné du sens au temps. L’homme réalise son essence à travers le temps. Cette structure de l’attente, de l’espérance et de l’accomplissement, cette conception du temps conditionne la politique – la religion politique est la sécularisation de la rédemption, de l’eschatologie, du salut, du jugement dernier. Mais aujourd’hui ce dernier cycle a pris fin. Nous avons quitté l’histoire pour la nature : cela s’appelle l’écologie.
Aujourd’hui, les hommes ne pensent plus temps, progression, mais espace. Nous sommes des païens avec des instruments de mesures très légitimes sur le CO2, la montée des eaux, autant de choses que la religion de l’histoire avait exclues. Celle-ci est punie par là où elle avait péché puisqu’elle avait oublié la nature et privilégié la construction d’usine, le tracé des routes, etc. Chaque période de l’histoire fait expier à la précédente son impensé : nous n’avions pas
pensé la nature et maintenant ceux qui pensent la nature tendent à oublier la dynamique historique des conflits, pour une notion plus orientale d’harmonie cosmique.
Vous remarquerez au passage que l’on parle sans cesse de mémoire mais on n’apprend plus rien par coeur. Comme pour confirmer cette évolution, la Chine sera bientôt la puissance rectrice – elle l’est déjà économiquement, elle le sera politiquement, financièrement…
Quel regard portez-vous sur l’action des responsables politiques actuels ?
J’ai écrit naguère un livre intitulé L’Etat séducteur, afin de raccorder la chose publique à l’état des techniques. La politique, c’est la profondeur du temps – en arrière et en avant. Face à l’événement, Charles de Gaulle le raccorde àun événement historique, ce qui lui permet de dire que l’invasion de Prague en 1968 est un épiphénomène et de parler de la Prusse quand il est en Allemagne de l’Est. Aujourd’hui, la réaction est instantané, dépourvue de recul et de relief. Nous vivons une démocratie plébiscitaire "quotidianisée", assouplie par le sondage du jour. Le journaliste a domestiqué le politique. Le président est devenu le rédacteur en chef du pays.
Au milieu du XXe siècle, le journaliste était encore au service du politique; ensuite, le politique s’est mis au service du journaliste – il fallait passer au journal de vingt heures… Et maintenant, le bon politique choisit ce dont on va parler. Au lieu de courir après les médias, il choisit de prendre le contrôle des médias. Souvenez-vous que l’unique attaché de presse de De Gaulle était installé dans un comble du troisième étage. Mitterrand avait une équipe de cinq personnes située au rez-de-chaussée. Cela doit être multiplié par dix aujourd’hui.
Comment analysez-vous l’échec de la conférence de Copenhague ?
Vous me faites parler de ce que je ne connais pas. Mais je pose une question
de méthode. J’ai entendu des écologistes dire leur stupéfaction, leur incompréhension
devant ce qu’ils estiment être la bêtise et l’irresponsabilité des politiques.
Sans doute tous ces chefs d’Etat déraisonnent-ils mais alors, il y a une coïncidence dans la déraison parce que, tout de même, les représentants de 75 Etat-nations ont participé à ce fiasco. Si j’étais Yann Arthus Bertrand ou Nicolas Hulot, je me demanderais si ma grille d’analyse correspond à la réalité. Je me dirais : " Nous sommes mille personnes dans le monde, une élite certes, mais les hommes d’Etat travaillent pour des milliards d’humains… Se trompent-ils à ce point ?
Est-ce que les notions que j’ai liquidées – la souveraineté, l’égoïsme des nations – ne correspondent-elles pas à quelque chose, encore aujourd’hui ? Ne suis-je pas en train de défendre une raison utopique, sans prendre en compte le principe de la réalité ? Je ne mésestime pas les alertes qui concernent le climat. Mais lorsque des responsables de haut niveau venus de tous les coins du monde tiennent le même langage, il faut s’interroger sur soi-même autant que sur eux. (...)
Dans votre dernier livre, vous regrettez la disparition de la fraternité…
Un symptôme incroyable de la déchristianisation des mentalités dans notre pays est que le mot fraternité fait tordre de rire les intellectuels. "Bon pour les scouts et les chrétiens", tranche-t-on à Saint-Germain-des-Prés, où vous ne trouverez pas ce livre. Le mot " fraternité" a été inventé par les premiers Pères de l’Eglise. Pour qui n’a pas lu saint Paul, cette notion est du bon sentiment pur. C’est en fait une vision du monde, visant à remplacer la fratrie biologique par la fraternité des valeurs. C’est un déverrouillage des cycles de la nature, dont nous restons tributaires.
Quand l’affiliation au père symbolique s’en va, ce sont les filiations naturelles et tribales qui reviennent. Nous y sommes. C’est le moment de redevenir chrétiens en esprit, je veux dire républicains et non païens. La fraternité a été intégrée à la devise de la République par les chrétiens sociaux lors de la révolution de 1848. Nous avons perdu le sens de cet héritage. L’humanisme républicain intégrait la grande construction théologique de l’Histoire et la Réforme… Retrouvons le sens de la durée. L’humanisme comme le christianisme se vivent au jour le jour mais ne sont pas du quotidien. Ils donnent de la profondeur au temps, vers l’arrière et vers l’avant.
"La fraternité est une essence rare"
Du Père et de sa Loi, le procès est derrière nous, le verdict rendu, beaucoup ont tourné la page. De la Mère et du maternage a été dénoncée, avec tout ce qu’a de régressif et d’infantilisant la Big Mother. C’est désormais et par ricochet du Frère qu’il nous est demandé, en Europe, de faire le deuil. C’est là que le bât blesse. Et c’est cette blessure qu’on voudrait sinon soigner ou guérir, du moins débrider, aviver et approfondir. La fraternité est une essence rare, qui se consomme sur ordonnance, diluée et en prises espacées – avec la solidarité de l’Etat providence –, ou bien vaporisée en convivialité, pour de brèves euphories, ou alors au compte-gouttes, en tête-à-tête, sous l’étiquette amitié. Le policier garde de l’estime pour son collègue. L’avocat ou le médecin pour son confrère. L’ancien élève pour son condisciple, le footballeur pour son co-équipier, l’engagé pour son camarade de régiment, l’ébéniste du Tour de France pour son compagnon. C’est tant mieux mais pas assez. Notre chère petite personne aspire à plus et à mieux ; pouvoir appeler frère ou soeur un étranger qui ne porte pas son nom. De cette grâce précaire qu’est une famille élective, de ce bonheur insolite et dangereux certes, mais que rien ne remplace, le rêve ou la mélancolie ne veulent pas mourir, étrangement. La débâcle du communisme, l’étouffoir communautaire, la phobie du sectaire et du totalitaire ont suggéré à de bons esprits qu’il fallait passer un bracelet électronique au suspect “communauté”.
Extrait de Le Moment fraternité, Régis Debray, Gallimard